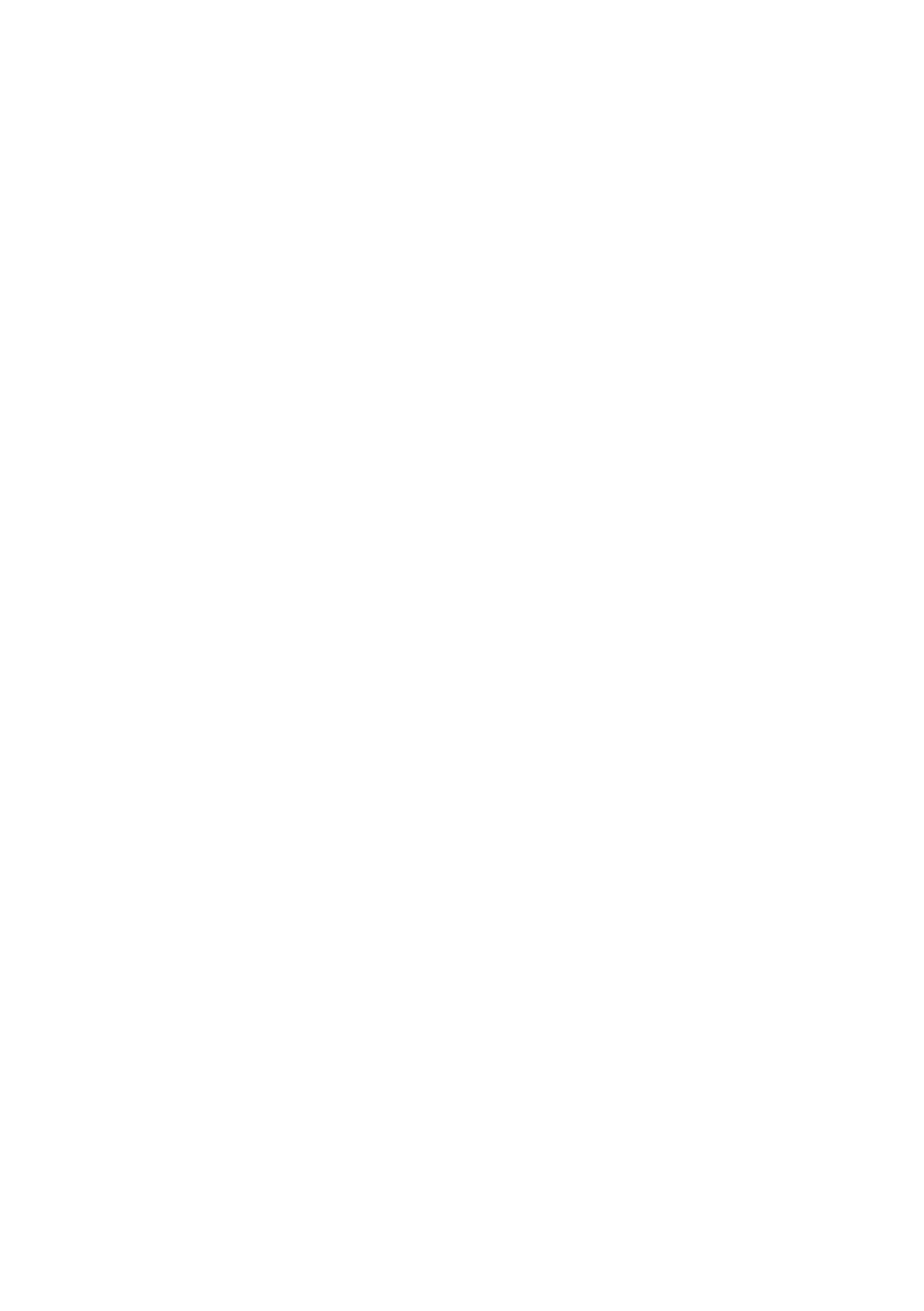Lettre d’information franco-allemande | Automne 2023
Actualités France
- CORPORATE - La distribution de dividendes en dehors de l’assemblée générale annuelle
- CORPORATE – Simplification de certaines démarches administratives par suppression du Kbis et instauration du Registre National des Entreprises dans le cadre de la loi PACTE
- DROIT COMMERCIAL – La Cour de cassation uniformise le délai pour exercer l’action en garantie des vices cachés
- DROIT COMMERCIAL – Le Conseil d’Etat annule l’interdiction du Point vert et valide pour sa part le logo Triman
- DROIT DU TRAVAIL – Accord-cadre permettant le maintien au régime de sécurité sociale de l’État d'emploi des télétravailleurs transfrontaliers
- DROIT DU TRAVAIL - Acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie
- DROIT DU TRAVAIL - De l’intérêt de contester les certificats médicaux de complaisance
- CONTENTIEUX – Deux nouveaux dispositifs de règlement amiable des litiges voient le jour en novembre 2023
- DROIT IMMOBILIER – Baux commerciaux et taxes d’urbanismes
- DROIT IMMOBILIER - La demande en constatation du bail commercial statutaire n’est pas soumise à prescription
- DROIT IMMOBILIER – La cession du fonds de commerce comprenant un bail commercial est soumise à l’agrément du bailleur
- DROIT DE L‘ENVIRONNEMENT – Les installations classées pour la protection de l’environnement dans le cadre d’un bail commercial
- DROIT DE LA SANTE – Sur la légitimité de l’abonnement à des téléconsultations médicales non remboursées par la Sécurité Sociale
- PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL - Panorama de décisions récentes de la CNIL
- PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL - Un nouveau cadre légal pour les transferts de données vers les Etats-Unis
- TECHNOLOGIES EMERGENTES ET PROJETS A IMPACTS – Etat des lieux du règlement européen sur l’Intelligence artificielle (AI Act)
- TECHNOLOGIES EMERGENTES ET PROJETS A IMPACTS - Une évidence vertueuse par nature ? Le bitcoin et les critères ESG
- DROIT DE LA SANTE – La loi sur les influenceurs impacte les entreprises du secteur de la santé
Actualités France
CORPORATE - La distribution de dividendes en dehors de l’assemblée générale annuelle
Par un jugement du 23 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Paris remet en question l’actuelle pratique commerciale courante de distribution de dividendes en dehors de l’assemblée générale annuelle. La position que prendra la cour d’appel de Paris ou, en cas de pourvoi, la Cour de cassation est très attendue.
Les distributions de dividendes font partie des pratiques commerciales courantes et résultent des comptes annuels. Elles se basent sur le report de bénéfice, les réserves distribuables des années précédentes ou le bénéfice annuel du dernier exercice. Une distribution ordinaire de dividendes est toujours fondée sur l’assemblée générale annuelle ordinaire. Celle-ci approuve le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels et décide de l’affectation des bénéfices, qui seront éventuellement distribués sous forme de dividendes.
Mais la distribution de dividendes extraordinaires, également appelés dividendes intermédiaires, est aussi une pratique courante. En droit des sociétés, il s’agit de distributions qui ne sont pas décidées dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire annuelle et qui ne sont donc pas directement liées au résultat de l’exercice précédent. Il s’agit également des distributions de bénéfices et de pertes reportés ainsi que des primes de toute nature.
Cette pratique se fonde sur les articles L. 232-11, alinéa 2, et L. 232-12, alinéa 1, du Code de commerce et a depuis été confirmée sans exception par la jurisprudence, la doctrine, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), et par un avis juridique de l’Association nationale des sociétés anonymes (ANSA).
Il est d’autant plus surprenant que le Tribunal de commerce de Paris semble vouloir mettre un terme à cette pratique en jugeant, dans sa décision du 23 septembre 2022, qu’il « ne peut être sérieusement soutenu que l’alinéa 2 de l’article L.°232-11 […] permettrait, en l’absence de dispositions contraires, un autre mode de distribution que celui-ci, alternatif, qui résulte de l’article L.°232-12 […] et que les sociétés auraient, dans le silence des textes, la possibilité de procéder librement à des distributions de sommes prélevées sur les réserves ». Une telle interprétation peut avoir des conséquences importantes dans le pire des scénarios, notamment la nullité de la décision des associés correspondante ou la responsabilité pénale et civile des dirigeants.
Le véritable problème d’une telle interprétation par le Tribunal de commerce de Paris est avant tout l’atteinte à un principe fondamentale de la sécurité juridique : « Tout ce qui n’est pas interdit est autorisé ». Ainsi, les sociétés se retrouvent dans une situation d’incertitude concernant les distributions de dividendes hors assemblée générale ordinaire, qui ne devrait pas prendre fin de sitôt. Les répercussions de ce jugement porteront sûrement l’affaire jusqu’à la Cour de cassation.
Conseil de GGV : En attendant, nous vous recommandons de ne pas surestimer l’importance de ce jugement. Certes, vous devriez, dans la mesure du possible, privilégier une distribution de dividendes dans le cadre de l’assemblée générale d’approbation des comptes annuels. Cependant, nous pensons qu’une distribution extraordinaire de dividendes reste possible jusqu’à nouvel ordre. Par précaution, vous pouvez l’associer à un rapport intermédiaire du commissaire aux comptes.
CORPORATE – Simplification de certaines démarches administratives par suppression du Kbis et instauration du Registre National des Entreprises dans le cadre de la loi PACTE
La Loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, prévoit plusieurs mesures de simplification pour les entreprises. Ainsi, la présentation d’un extrait Kbis n’est plus nécessaire pour 55 démarches administratives. En outre, un registre unique, le Registre National des Entreprises (RNE), remplace désormais plusieurs registres existants.
Simplification de certaines démarches administratives
L’extrait Kbis, véritable « carte d’identité » officielle d’une société ayant une activité commerciale, contient, entre autres, l’identité de la société, l’adresse de son siège social, le montant du capital social, les membres de la direction, le nom du commissaire aux compte,… Or, pour certaines démarches administratives, il n’est plus nécessaire pour une société de présenter son extrait Kbis à jour. Désormais, il suffit de communiquer le numéro SIREN, avec lequel les administrations peuvent consulter les informations relatives à la société sur un site internet dédié à cet effet.
Les démarches concernées par cette réforme concernent non seulement des déclarations, agréments ou autorisations, mais aussi différents secteurs, comme les produits énergétiques, l’urbanisme, les travaux d’intérêt générale, l’agriculture, le transport, ou bien les procédures collectives ou des autorisations d’exploitation commerciale ou la propriété intellectuelle.
Dans la liste des 55 démarches ne nécessitant plus d’extrait Kbis se trouvent, parmi d’autres, les démarches suivantes :
- Candidature à un marché public,
- Requête aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation adressée au président du tribunal,
- Demande d’autorisation d’exploitation commerciale,
- Autorisation d’ouverture de commerce de détail,
- Demande de carte professionnelle (agents immobiliers, administrateurs de biens, etc.),
- Obligation faite au porteur d’un projet de réseau d’infrastructures nécessaires à la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur l’espace public d’adresser une demande d’approbation du projet au ministre chargé de l’industrie
Une liste détaillée des démarches concernées se trouve ici.
Les artisans et les professions libérales ne sont pas concernés par ces dispositions de la loi PACTE, car pour eux, faute d’activité commerciale, il n’existe pas d’extrait Kbis. Ils peuvent simplement fournir leur numéro SIREN pour toute démarche administrative.
Instauration du Registre National des Entreprises (RNE)
Depuis le 1er janvier 2023, le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), le Répertoire des Métiers (RM) et le Registre des Actifs Agricoles (RAA) ont fusionné en un seul registre dématérialisé. Cette fusion concerne donc, contrairement à la simplifications des démarches administratives décrite ci-dessus, non seulement les sociétés commerciales, mais aussi toute activité de nature artisanale, agricole ou indépendante.
L’INPI seul est compétent pour l’alimentation et la mise à jour du RNE. Ce dernier contient les données connues du Guichet Unique des formalités d’entreprises. Les données renseignées par les déclarants (avocats, entreprises) lors de la réalisation de leurs formalités sont automatiquement transmis au RNE. Pour certaines entreprises commerciales ou artisanales, les greffes ou les tribunaux judiciaires compétents en matière commerciale valident et contrôlent les données entrées par les utilisateurs au Guichet unique.
Ce nouveau registre unique est librement accessible au public, à l’exception de certaines données personnelles.
DROIT COMMERCIAL – La Cour de cassation uniformise le délai pour exercer l’action en garantie des vices cachés
Par quatre arrêts du 21 juillet 2023, la Chambre mixte de la Cour de cassation apporte des précisions bienvenues concernant la durée du délai d’action en garantie des vices cachés (notre précédent article sur le sujet ici).
Cass. Ch. Mixte, 21 juillet 2023, n°21-15.809, 21-17.789, 21-19.936, 20-10.763
Un délai de prescription de 2 ans à compter de la découverte du vice
Le débat portait sur la nature du délai d’exercice spécifique de l’action en garantie des vices cachés, d’une durée de 2 ans à compter de la découverte du vice par l’acheteur (article 1648 du Code civil).
Si le délai était considéré comme un délai de forclusion, alors il n’était pas susceptible de suspension. Cela signifie que lorsqu’une mesure d’instruction avait été ordonnée, le délai d’action n’était pas interrompu et continuait à courir. Si le délai était en revanche considéré comme un délai de prescription, alors il était susceptible de suspension pendant la durée de la mesure d’instruction.
La Cour de cassation a pris en compte l’objectif de la loi et de cette action, qui est de permettre à l’acheteur d’agir contre le vendeur et/ou le fabricant. Elle en a déduit que le délai d’action de 2 ans est un délai de prescription, susceptible de suspension.
Un délai butoir de 20 ans après la vente
Depuis 2018, la jurisprudence considérait majoritairement que le délai butoir de l’action était de 5 ans après la vente. Désormais, la Cour précise que l’action en garantie des vices cachés est encadrée par un délai butoir de 20 ans à compter de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (article 2232 du Code civil).
Le délai d’action est donc élargi à 20 ans après la vente, ce qui vise à garantir un équilibre entre les différents intérêts des vendeurs, fabricants et acheteurs.
Une précision bienvenue pour les actions des constructeurs envers leurs fournisseurs
Le double délai d’action concerne aussi bien les ventes mobilières que les ventes immobilières, les ventes simples et les chaînes de contrats.
Ce double délai a un intérêt particulier pour les actions des constructeurs d’immeuble envers leurs fournisseurs.
En effet, le constructeur ne peut avoir connaissance des éventuels vices cachés des matériaux achetés avant la livraison de l’immeuble que lorsque le maître d’ouvrage l’assigne en justice. Or, il engage sa responsabilité décennale vis-à-vis du maître d’ouvrage dans un délai de 10 ans à compter de la livraison de l’immeuble. Si le délai de l’action en garantie des vices cachés avait été un délai de forclusion, alors le constructeur risquait de ne pas avoir de recours effectif contre ses fournisseurs.
A présent, le constructeur, assigné par son maître d’ouvrage dans un délai de 10 ans après la livraison de l’immeuble, pourra valablement engager la responsabilité de son fournisseur dans un délai de 2 ans à compter de la signification de l’assignation du maître d’ouvrage.
DROIT COMMERCIAL – Le Conseil d’Etat annule l’interdiction du Point vert et valide pour sa part le logo Triman
Le Conseil d’Etat a rendu deux décisions qui ne doivent pas faire oublier la nécessité de respecter les dispositions concernées de la loi.
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi AGEC, ouvrait la voie à l’interdiction de facto, par l’application d’une pénalité, de signalétiques et marquages considérés comme pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit. En application de cette disposition, des arrêtés des 30 novembre et 25 décembre 2020 ont interdit implicitement le bien connu logo Point vert, qui a depuis disparu graduellement des emballages en France. En effet, le logo Point vert, tel qu’il était utilisé en France, n’indiquait pas que l’emballage est recyclable ou fabriqué à partir de matière recyclée, seulement que le producteur avait payé une contribution pour le traitement des déchets. L’arrêté d’interdiction avait d’abord été suspendu par le Conseil d’Etat statuant en référé le 15 mars 2021. Par une nouvelle décision du 30 juin 2023 sur requête, entre autres, de la société Der Grüne Punkt Duales System Deutschland GmbH, le Conseil d’Etat annule définitivement l’arrêté. il est donc, pour le moment, de nouveau légal d’apposer le Point vert sur un emballage en France. Toutefois, il est probable que le gouvernement reprenne un arrêté interdisant de fait le Point vert, d’autant plus que les arrêtés de 2020 ont été annulés pour un motif de forme.
Conseil de GGV : en attendant la réaction du gouvernement, il est donc prudent de ne pas remettre un Point vert sur les emballages commercialisés en France.
Par une autre décision du 21 avril 2023, le Conseil d’Etat a également confirmé la légalité et la conformité, à ses yeux, au droit européen et conventionnel du décret d’application relatif au logo Triman, également introduit par la loi AGEC. Toutefois, une procédure reste en cours contre le logo Triman au niveau européen, comme mentionné dans un de nos précédents articles. La Commission reproche à la France de ne pas l’avoir notifiée avant l’adoption de la loi AGEC en 2020, et de n’avoir pas procédé à une analyse suffisante de la proportionnalité de cette mesure au regard du principe de libre circulation des marchandises.
Conseil de GGV : en attendant, il convient de continuer d’appliquer les dispositions relatives au logo Triman pour les produits commercialisés en France.
Dans les deux cas, GGV vous tiendra bien évidemment informé de la suite concernant les logos Point vert et Triman.
DROIT DU TRAVAIL – Accord-cadre permettant le maintien au régime de sécurité sociale de l’État d'emploi des télétravailleurs transfrontaliers
La période transitoire, pendant laquelle les effets du télétravail transfrontalier sur la législation sociale applicable aux salariés exerçant une part substantielle de leur activité en télétravail dans leur Etat de résidence ont pu être neutralisés, a pris fin le 30.03.2023. Après concertations entre les Etats membres, un accord-cadre dérogatoire aux règlements européens, pris sur le fondement de l’article 16 du Règlement (CE) n° 883/2004, a été mis en place avec effet au 01.07.2023, pour une durée initiale de 5 années. Cet accord permet le maintien au régime de sécurité sociale de l’État d’emploi des travailleurs transfrontaliers qui télétravaillent plus de 25 % et moins de 50 % de leur temps dans leur État de résidence. Il est aujourd’hui en vigueur dans 19 Etats européens, dont la France et l’Allemagne.
L’article 13 § 1 a) du Règlement (CE) n°883/2004 prévoit l’affiliation au régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence lorsque le salarié exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat et le reste de son activité dans un autre Etat. Il ressort de l’article 14 § 8 du Règlement (CE) n°987/2009 que le salarié exerce une partie substantielle de ses activités dans l’Etat de résidence dès lors qu’il y exerce au moins 25% de son temps de travail.
L’accord-cadre permet de déroger à ces dispositions, en faveur des télétravailleurs, sous réserve que la part de télétravail effectuée dans l’Etat de résidence soit inférieure à 50 % du temps de travail et que l’Etat de résidence du salarié et l’Etat du siège de l’employeur aient signé l’accord-cadre.
Cette dérogation ne peut être demandée que pour un salarié qui n’a qu’un seul employeur ou dont les différents employeurs ont leurs sièges dans un même Etat membre. Sont exclus du bénéfice de l’accord-cadre les travailleurs indépendants.
L’accord-cadre a également mis en place une procédure simplifiée pour l’application de l’article 16 du Règlement (CE) n°883/2004, qui doit être déclenchée par l’employeur avec l’accord du salarié intéressé.
La demande de dérogation doit être adressée à l’organisme compétent de l’Etat dans lequel est établi l’employeur. Si les conditions sont remplies, cet organisme délivre ensuite le document portable A1 qui atteste du maintien de la législation sociale applicable. La durée maximale de la dérogation est de 3 ans, des prolongations pouvant être accordées.
Pour rappel, l’attestation A1 lie les autorités et les juridictions de l’Etat membre dans lequel le salarié exerce son activité aussi longtemps qu’elle n’est pas retirée ou déclarée invalide par l’organisme l’ayant délivrée.
Conseil de GGV : Si vous employez de salariés qui exercent de façon habituelle leur activité en télétravail transfrontalier, nous vous conseillons d’examiner ensemble leur situation afin de déterminer l’opportunité de solliciter la délivrance d’une attestation A1 sur le fondement de l’accord-cadre.
DROIT DU TRAVAIL - Acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie
Par plusieurs arrêts rendus le 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a mis en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés, permettant ainsi l’acquisition de congés payés par les salariés pendant leurs périodes d’absences pour raisons de santé
Jusqu’à présent, il résultait des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du Code du travail qu’un salarié ne pouvait pas acquérir de jours de congés payés en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle se prolongeant au-delà d’une année.
Or, la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative au temps de travail prévoit que tout travailleur a droit à des congés annuels payés d’une durée minimale de 4 semaines. En application de cette directive, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé qu’un salarié absent pour raison de santé ne pouvait pas voir sa durée de congés payés portée en dessous de 4 semaines, peu importe l’origine professionnelle ou non professionnelle de son absence ainsi que sa durée.
Afin de conformer le droit français au droit européen, la Cour de cassation a écarté les dispositions précitées du Code du travail et décidé d’une part que les salariés en arrêt maladie ou victimes d’un accident, professionnel ou non professionnel, ont le droit d’acquérir des congés payés durant leur absence et d’autre part que l’indemnité compensatrice de congés payés ne peut plus être limitée à la première année d’absence en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Le salarié continue donc d’acquérir des congés pendant toute la durée de son arrêt de travail.
En outre, la Cour de cassation a précisé que la prescription du droit à congés payés ne court qu’une fois que l’employeur a mis le salarié en mesure d’exercer ses droits à congés payés.
Conseil de GGV : Informer le salarié, à sa reprise, de son droit à congés payés sur sa période d’absence, afin de faire courir le délai légal de prescription.
DROIT DU TRAVAIL - De l’intérêt de contester les certificats médicaux de complaisance
Un certificat médical engage son auteur et peut être contesté dès lors qu’il est établi en violation des règles déontologiques des médecins et du Code de la santé publique.
Il arrive bien souvent qu’un salarié qui se plaint de harcèlement moral ou de souffrance au travail produise devant les juridictions prud’homales un certificat médical d’arrêt de travail ou une attestation d’un médecin, mentionnant qu’il souffre d’un syndrome anxio-dépressif « réactionnel au travail » ou « en rapport avec des difficultés au travail ».
En établissant un tel certificat ou une telle attestation, le praticien certifie ou atteste que l’état de santé de son patient est en lien avec ses conditions de travail. Pourtant, dans la plupart des cas, il n’a pas personnellement constaté les conditions de travail de son patient, ni l’existence d’un lien entre ces conditions et son état de santé.
Ce faisant, le praticien contrevient à ses obligations déontologiques ainsi qu’aux dispositions du Code de santé publique qui interdisent la délivrance d’un certificat de complaisance et lui imposent, pour tout certificat ou attestation qu’il établit, de s’en tenir aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire et de ne certifier que ce qu’il a personnellement constaté.
Confronté à un tel certificat, l’employeur est en droit de le contester devant le conseil départemental de l’ordre des médecins auprès duquel le médecin qui l’a établi est inscrit. Le conseil départemental de l’ordre des médecins doit alors convier le médecin et l’employeur à une séance de conciliation, laquelle donne généralement lieu à une rectification du certificat ou de l’attestation contesté et à une conciliation.
L’intérêt premier d’initier une telle procédure est ainsi d’obtenir rectification du certificat trompeur produit par le salarié au soutien de ses prétentions.
Il est, de la même manière, possible de contester les éléments médicaux trompeurs produits au soutien d’une demande de reconnaissance d’un syndrome dit de burn out ou d’épuisement professionnel au titre des maladies professionnelles.
En effet, la décision de prise en charge d’une telle pathologie par la caisse primaire d’assurance maladie entraine plusieurs conséquences :
- elle fournit des éléments supplémentaires pour convaincre un conseil de prud’hommes de l’existence d’une situation de harcèlement moral ou de souffrance au travail que le salarié impute à l’employeur
- elle entraine une augmentation du taux des cotisations accident du travail et maladie professionnelle versées chaque mois par l’employeur
- le salarié pourra, dans le cadre d’une mise en cause de l’employeur au titre de sa faute inexcusable, obtenir la condamnation de l’employeur à l’indemniser de divers préjudices ainsi qu’une majoration de la rente servie par la CPAM – ce qui se répercutera sur le montant des cotisations accident du travail et maladie professionnelle.
Conseil de GGV : Les enjeux financiers étant majeurs, GGV Avocats-Rechtsanwälte recommande aux employeurs de contester systématiquement les certificats médicaux de complaisance.
CONTENTIEUX – Deux nouveaux dispositifs de règlement amiable des litiges voient le jour en novembre 2023
Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire
Deux nouvelles procédures de règlement amiable des litiges entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2023 : l’audience de règlement amiable et la césure du procès.
Ainsi, pour toutes les affaires introduites à compter du 1er novembre 2023, le tribunal judiciaire aura la faculté de proposer aux parties de mettre en œuvre l’un de ces deux mécanismes, dans les instances au fond comme en référé, afin de faciliter la résolution amiable du litige.
L’audience de résolution amiable du litige
A partir du 1er novembre 2023, le juge de la mise en état ou le Président du tribunal judiciaire pourra décider de convoquer les parties à une audience de résolution amiable, soit à la demande d’une des parties, soit d’office, après avoir recueilli l’avis des parties (art. 774-1 et s. CPC).
La décision revêt la forme d’une mesure d’administration judiciaire : elle n’est donc pas susceptible de recours.
Lors de l’audience de résolution amiable, les parties sont tenues de comparaître en personne. Elles sont accompagnées de leur avocat, s’il s’agit d’une procédure où le ministère d’avocat est obligatoire.
Le juge organise librement le déroulement de l’audience : il peut prendre connaissance des conclusions et pièces des parties, décider d’entendre les parties ensemble ou séparément, etc.
L’audience a lieu en chambre du conseil. Tous les échanges oraux et écrits sont confidentiels.
A l’issue de cette audience, le juge pourra, à la demande des parties, constater l’accord partiel ou total des parties ; en revanche, il ne pourra pas homologuer l’accord intervenu. Il informera le juge saisi du litige de la fin de l’instance, en lui transmettant le procès-verbal d’accord.
Si aucun accord n’a pu être trouvé, le juge pourra mettre un terme prématurément à l’audience.
Il ne pourra pas siéger ultérieurement dans la formation de jugement.
La césure du procès
Pour l’adoption de ce mécanisme, le Ministère de la justice a puisé son inspiration dans le système judiciaire allemand. A compter du 1er novembre 2023, le juge pourra scinder le litige et trancher uniquement certaines des prétentions des parties dans un premier temps (art. 807-1 CPC).
La césure du procès n’est envisageable qu’à la demande de l’ensemble des parties à l’instance. Les parties devront s’accorder sur les prétentions que le tribunal devra trancher au fond et produire au juge un acte contresigné par avocats mentionnant les prétentions qui seront l’objet d’un jugement partiel. Si le juge estime la demande fondée, il ordonne la clôture partielle de l’instruction et renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond sur les prétentions qui font l’objet de la césure. Le jugement partiel ne sera pas revêtu de plein droit de l’exécution provisoire et pourra faire l’objet d’un appel (art. 807-3 CPC).
Cette césure du procès est censée permettre aux parties de trouver une issue amiable sur les demandes qui n’ont pas été tranchées par le tribunal. Le Garde des Sceaux vient de le rappeler expressément dans une circulaire du 17.10.2023 mettant en œuvre le décret.
Par exemple, en cas de litige concernant la responsabilité contractuelle d’un cocontractant, le juge pourra trancher la seule question de la responsabilité de ce cocontractant. Si le tribunal juge que le cocontractant engage sa responsabilité, alors les parties pourront tenter de résoudre à l’amiable le litige concernant le montant des dommages et intérêts en jeu.
GGV vous informe : ces deux mécanismes sont limités à ce jour aux litiges devant le tribunal judiciaire. Ainsi, les parties à une instance devant les tribunaux de commerce ne pourront pas demander d’audience de résolution amiable ou de césure du procès. Cependant, les parties peuvent toujours prévoir dans leur contrat de tenter de trouver un accord à l’amiable, avec l’aide d’un médiateur ou d’un conciliateur, avant toute procédure judiciaire. Les parties peuvent également convenir d’une convention d’arbitrage, afin de donner compétence à un tribunal arbitral pour trancher leurs litiges.
DROIT IMMOBILIER – Baux commerciaux et taxes d’urbanismes
La Cour de cassation a rappelé qu’en l’absence de stipulations expresses, les taxes d’urbanisme ne peuvent pas être imputées au locataire.
Dans un arrêt du 25 janvier 2023, la cour d’appel de Douai avait constaté que la clause du bail mettait à la charge du locataire « l’ensemble des taxes et impôts afférents aux locaux loués et notamment la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe foncière en fonction de la superficie louée »,et en a retenu qu’en l’absence de stipulations expresses, les taxes d’urbanismes ne pouvaient être imputées au locataire. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel considérant que les taxes d’urbanismes n’avaient aucun lien avec l’usage des lieux par le locataire.
Conseil de GGV : Si vous êtes bailleur, l’imputation au locataire des taxes doit faire l’objet de stipulations expresses dans votre contrat de bail commercial
DROIT IMMOBILIER - La demande en constatation du bail commercial statutaire n’est pas soumise à prescription
Par un arrêt du 25.05.2023, la Cour de cassation a opéré une précision majeure sur la prescription de l’action en constatation d’un bail commercial statutaire née du maintien dans les lieux du locataire à l’expiration d’un bail dérogatoire.
Les parties à un bail peuvent convenir de ne pas appliquer le statut des baux commerciaux lorsqu’elles concluent un bail, appelé alors bail dérogatoire. Ce bail ne peut durer qu’au maximum trois ans (art. L. 145-5 C. com.). Passé ce délai, les parties ne peuvent plus passer outre le statut des baux commerciaux.
En l’espèce, les parties avaient conclu un premier bail dérogatoire de deux ans le 14.06.2004. Puis le 01.05.2006, elles ont conclu un nouveau bail dérogatoire se terminant le 30.09.2006. A l’issue de ce contrat, le preneur est resté dans les lieux et a été laissé en possession, payant un loyer. Ce n’est qu’à compter du 01.12.2016 que le bailleur a demandé au preneur de payer une indemnité d’occupation.
Le preneur a alors saisi le tribunal, afin qu’il constate que le bail était soumis au statut des baux commerciaux. Le bailleur a fait valoir que l’action en reconnaissance du statut des baux commerciaux était prescrite au bout de cinq ans à compter du début du bail dérogatoire, soit en l’espèce depuis le 14.06.2009.
La cour d’appel a donné raison au bailleur, et a déclaré prescrite l’action du preneur.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel.
Dans son arrêt, la Haute juridiction a jugé que l’action en constatation de l’existence d’un bail statutaire né du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire est imprescriptible.
En effet, si le preneur reste dans les locaux sans contestation du bailleur plus d’un mois après l’expiration du bail dérogatoire, un nouveau contrat de bail s’opère, soumis au statut des baux commerciaux. Ainsi, au terme d’un bail dérogatoire de trois ans, le bailleur comme le preneur pourront à tout moment solliciter la reconnaissance du bail devenu statutairement commercial, sans être tenu de le faire dans un délai spécifique.
GGV vous informe : Le bailleur comme le preneur souhaitant mettre un terme à un bail dérogatoire de trois ans devront faire preuve de vigilance en exprimant par des actes positifs et non équivoques leur volonté de mettre fin à leur relation contractuelle. A défaut, l’une des parties pourra demander la reconnaissance du statut de bail commercial, ce qui suppose notamment un bail de neuf ans et des obligations légales supplémentaires, notamment pour le bailleur.
DROIT IMMOBILIER – La cession du fonds de commerce comprenant un bail commercial est soumise à l’agrément du bailleur
Cass. Com. 19 avril 2023, n°21-20.655
Le cédant d’un fonds de commerce comprenant un droit au bail doit demander l’agrément du bailleur, dès lors que le contrat de bail commercial le prévoit. La Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt du 19 avril 2023, dans le cadre d’une cession de fonds de commerce d’une société en liquidation judiciaire.
Dans cette affaire, une société a conclu un bail commercial qui prévoyait que le preneur devait obtenir l’agrément du bailleur en cas de cession de son droit au bail.
Le preneur a ensuite fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire du preneur a souhaité céder le fonds de commerce du preneur. Ayant trouvé un cessionnaire, il a demandé et obtenu l’autorisation du juge-commissaire pour conclure ladite cession du fonds de commerce.
Cependant, le bailleur s’est opposé à la cession du droit au bail du preneur. Il a donc saisi le juge afin de contester la cession du fonds de commerce du preneur.
La cour d’appel a rejeté la demande du bailleur. Elle a considéré que la clause du bail commercial qui prévoit l’agrément du bailleur en cas de cession du droit au bail ne s’appliquait qu’en cas de cession du droit au bail et non pas en cas de cession du fonds de commerce.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel. En effet, elle a jugé qu’en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou incluse dans celle du fonds de commerce, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Ainsi, le bailleur est en droit d’appliquer la clause du bail commercial qui soumet la cession du droit au bail du preneur à son agrément.
Cette jurisprudence s’applique a priori pour toute cession du fonds de commerce comprenant un droit au bail commercial.
Ainsi, en cas de cession du fonds de commerce, le preneur doit nécessairement obtenir l’agrément de la part du bailleur si le bail commercial l’y oblige, ce qui est très souvent le cas en pratique. Cet agrément de la part du bailleur reste en principe une pure formalité, sauf refus dûment justifié.
GGV vous informe : Le preneur à bail commercial devra porter une attention particulière à la clause de cession du droit au bail en cas de négociation d’un bail ou d’un renouvellement. En cas de cession de son fonds de commerce et si le contrat de bail le prévoit, le preneur devra prévoir l’agrément du bailleur avant de finaliser ladite cession. En cas de refus de cession, le bailleur devra dûment justifier ce refus, sous peine de devoir des dommages et intérêts au preneur.
DROIT DE L‘ENVIRONNEMENT – Les installations classées pour la protection de l’environnement dans le cadre d’un bail commercial
Les règles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) doivent faire l’objet d’une attention particulière, que ce soit en cas d’acquisition ou dans le cadre d’un bail commercial.
Peut être qualifiée d’ICPE, en substance, toute exploitation industrielle ou agricole qui peut présenter des dangers et/ou des inconvénients soit pour les tiers, soit pour la protection de l’environnement et des sols. Les ICPE sont de ce fait soumises à des dispositions légales spécifiques. Ces règles influent sur le bail commercial, tant sur les obligations du preneur que sur celles du bailleur.
Ainsi, le locataire exploitant une ICPE doit notifier auprès de l’autorité administrative compétente non seulement l’exploitation d’une ICPE, mais également son arrêt. L’autorité administrative peut alors obliger l’exploitant à prendre des mesures spécifiques pour dépolluer et réhabiliter le site. Dès que l’exploitant a mis en œuvre ces mesures, l’autorité administrative établit un procès-verbal de récolement confirmant que les mesures nécessaires pour la réhabilitation du site ont été valablement mises en œuvre. Cependant, ces règles de réhabilitation sont strictes. En effet, si le locataire exploitant ne réalise pas les travaux de réhabilitation au jour de son départ des lieux, il est alors redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’obtention du procès-verbal de récolement établi par l’autorité administrative (Cass. Civ. 3ème, 11 mai 2022).
De son côté, le bailleur est tenu d’un devoir d’information vis-à-vis du locataire. En effet, il doit informer le locataire par écrit des informations publiées par l’Etat faisant état, pour le terrain concerné par le bail, de risques existants en matière de pollution des sols (art. L. 125-7 C. env.). A défaut, si le locataire constate une pollution rendant le terrain impropre à la destination indiquée dans le bail, ce dernier peut demander la résiliation du bail ou une diminution du loyer dans un délai de deux ans à compter de la constatation de la pollution.
GGV vous informe : ces exemples mettent en exergue que l’examen des règles environnementales est indispensable en matière de bail commercial, que ce soit dans le cadre de négociations précontractuelles ou lors de l’emménagement dans de nouveaux locaux. Nous sommes à votre disposition pour ce faire.
DROIT DE LA SANTE – Sur la légitimité de l’abonnement à des téléconsultations médicales non remboursées par la Sécurité Sociale
Communiqué de presse, CNOM, 8 juin 2023
Le Conseil National de L’Ordre des Médecins (CNOM) a rendu le 8 juin 2023 un avis défavorable, qualifiant cet usage de pratique mercantile interdite par le Code de la santé publique.
En effet, depuis un an, le groupe de cliniques privées Ramsay Santé propose à ses patients une offre d’abonnements à hauteur de 11,80 euros par mois pour bénéficier de téléconsultations illimitées avec des médecins spécialisés dans différents domaines.
Le CNOM s’est cependant opposé à cette initiative, considérant que cet abonnement serait contraire à la déontologie médicale, notamment car il vise à exercer la médecine comme un commerce. De plus, selon le CNOM, le fait que ces téléconsultations médicales ne soient pas remboursées par l’Assurance maladie mais soient à la charge du patient, est contraire aux principes de solidarité et de gratuité des soins, pierre angulaire du système de santé français.
Le CNOM a donc demandé au ministre de la Santé d’adopter tout texte réglementaire permettant de lutter contre le mauvais usage de la télémédecine.
Conseil de GGV : si vous souhaitez implanter des téléconsultations en France, restez vigilants ! La règlementation applicable et la déontologie médicale des médecins restent très restrictives sur ce sujet.
PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL - Panorama de décisions récentes de la CNIL
Parmi les décisions importantes rendues par la CNIL au cours des derniers mois, figure tout d’abord la décision de sanction rendue le 11 mai 2023 contre la société et plateforme en ligne DOCTISSIMO. Cette société exploite le site web doctissimo.fr sur lequel elle propose principalement des articles, tests, quiz et forums de discussion en lien avec la santé et le bien-être, à destination du grand public. La CNIL avait été saisie d’une plainte formulée par une association (Privacy International) qui reprochait à la société DOCTISSIMO une série de manquements à la règlementation sur les données personnelles. Après différentes opérations de contrôle, la CNIL a finalement prononcé contre DOCTISSIMO une sanction à hauteur de 380.000 euros notamment pour ne pas avoir suffisamment sécurisé son site internet et les mots de passe des utilisateurs, pour ne pas avoir pris le soin de conclure des contrats valables avec ses prestataires, ou encore pour ne pas avoir mis en place de mécanisme de recueil du consentement des utilisateurs, alors que les données collectées par le biais de questionnaires en ligne étaient en partie des données de santé qui sont considérées comme sensibles par la règlementation.
Une autre affaire concerne la société CRITEO, spécialisée dans la publicité en ligne. La CNIL a prononcé contre cette société une sanction d’un montant de 40 millions d’euros, notamment pour ne pas avoir vérifié que les personnes dont les données étaient traitées avaient bien donné leur consentement. Pour comprendre l’enjeu de cette décision, il faut rappeler que la société CRITEO est un acteur majeur de la publicité en ligne et plus particulièrement du reciblage publicitaire.
Comme le précise la CNIL dans son communiqué de presse relatif à sa décision de sanction, le reciblage publicitaire consiste à suivre la navigation des internautes afin de leur afficher des publicités personnalisées. Pour cela, la société collecte les données de navigation des internautes grâce au traceur (cookie) CRITEO qui est déposé dans leurs terminaux lorsqu’ils se rendent sur certains sites web partenaires de CRITEO.
Or, en application de la Loi informatique et libertés, le dépôt d’un cookie sur le terminal d’un visiteur de site web requiert le consentement de ce dernier (sauf exceptions). En principe, il appartient à l’exploitant du site internet d’informer ses visiteurs en cas de recours à des cookies et de recueillir leur consentement, mais CRITEO devait s’assurer que ce consentement avait bien été recueilli et exiger de ses partenaires qu’il le prouve, ce qu’elle n’avait pas fait.
L’avis de GGV : Ces deux affaires montrent l’importance, pour toute entreprise exploitant un site internet 1/ de vérifier quelles données sont traitées à travers son site web, 2/ de s’assurer que le traitement des données ne requiert pas le consentement des personnes concernées ou de mettre en place un mécanisme de recueil du consentement, 3/ de vérifier si les mesures de sécurité requises sont mises en place pour protéger les données des utilisateurs et 4/ d’informer les visiteurs du site de tout traceur qui serait déposé sur leur terminal et recueillir leur consentement.
PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL - Un nouveau cadre légal pour les transferts de données vers les Etats-Unis
Le 10 juillet 2023, la Commission Européenne a adopté une nouvelle décision d’adéquation à travers laquelle elle reconnaît que les Etats Unis offrent un niveau de sécurité substantiellement équivalent à celui de l’Union Européenne en matière de données à caractère personnel.
Cette décision d’adéquation vient combler un vide laissé par une décision de la Cour de justice de l’Union européenne de juillet 2020. En effet, la haute juridiction européenne avait alors invalidé la précédente décision d’adéquation de la Commission Européenne. Pour en arriver là, la Cour avait considéré que la législation américaine en vigueur ne protégeait pas suffisamment les personnes dont les données étaient traitées par les fournisseurs de services internet et les entreprises de télécommunication, d’un accès inopiné par les services de renseignement américains.
Concrètement, l’adoption de la nouvelle décision d’adéquation a pour conséquence que les organismes qui sont soumis au RGPD (c’est-à-dire tous les organismes – entreprises, administrations, associations, organisations internationales, etc. – qui sont établis au sein de l’Union européenne ou qui traitent des données de citoyens européens) peuvent désormais de nouveau transférer des données vers les Etats Unis sans formalité autre que celle de vérifier que le destinataire des données est bien inscrite sur la liste des entreprises qui ont accepté de ses soumettre au cadre légal établi entre l’Union européenne et les Etats Unis. Cette liste peut être consultée sous le lien suivant : https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search
TECHNOLOGIES EMERGENTES ET PROJETS A IMPACTS – Etat des lieux du règlement européen sur l’Intelligence artificielle (AI Act)
L’IA est au cœur de toutes les préoccupations. Une place importante lui a d’ailleurs été réservée lors du séminaire des 9 et 10 octobre entre le Président Macron et le Chancelier Scholz. Mais qu’en est-il de sa régulation ?
Avec l’adoption de sa proposition de règlement sur l’intelligence artificielle par le Parlement européen le 14 juin 2023, les pourparlers vont pouvoir commencer entre les pays au sein du Conseil (Trilogue) avant son adoption envisagée pour la fin de l’année.
L’AI Act fournit une définition de ce qu’est un système d’intelligence artificielle, à savoir « un logiciel qui est développé au moyen d’une ou plusieurs des techniques et approches énumérées à l’annexe I et qui peut, pour un ensemble donné d’objectifs définis par l’homme, générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit ». Cette définition a été pensée pour être technologiquement aussi neutre que possible et donc à l‘épreuve du temps. L’annexe I liste les techniques d’approche et de développement de l’IA qui seront à adapter par la Commission à mesure que de nouvelles technologies apparaitront.
Plus simplement, l’IA repose avant tout sur un algorithme capable de reproduire des comportements humains sur la base de données qui lui auront été fournies. L’IA n’est donc ni artificielle, car elle repose sur une machine dotée d’une logique informatique, ni intelligente puisqu’elle ne fait que reproduire ou générer des informations à partir de données existantes.
Poursuivant l’objectif de systèmes d’IA sûrs, transparents, traçables, non discriminatoires et respectueux de l’environnement, le règlement sur l’IA suit une approche par les risques et prévoit des règles différentes selon les niveaux de risques.
Sont ainsi considérés comme inacceptables et donc interdits, le scoring social ou encore les systèmes d’identification biométriques en temps réel et à distance, tels que la reconnaissance faciale. Sous certaines conditions détaillées dans l’AI Act, les IA relevant notamment des domaines de l’identification biométrique et la catégorisation des personnes physiques, de l’éducation et la formation professionnelle, de l’emploi, la gestion des travailleurs, de la gestion de la migration, de l’asile et du contrôle des frontières, constituent des risques élevés et doivent à ce titre être évalués avant leur mise sur le marché et tout au long de leur cycle de vie. Ces systèmes d’IA à risques élevés devront faire l’objet d’un enregistrement dans une base de données européenne et se conformer à de nombreuses obligations de robustesse, de cybersécurité, de surveillance humaine, de gouvernance des données,…
Les systèmes d’IA à risques limités sont principalement soumis à des obligations de transparence ; quant aux systèmes d’IA à risques faibles, la création de codes de conduite est encouragée.
Une autorité nationale compétente devra être nommée par chaque Etat membre. Cette autorité nationale sera en charge de surveiller l’application de l’AI Act au niveau national et participera au Comité Européen de l’Intelligence Artificielle. Dans une étude publiée le 30 août 2022, le Conseil d’Etat a proposé de renforcer les pouvoirs de la CNIL et de faire évoluer son rôle pour qu’elle devienne l’autorité de contrôle nationale compétente prévue par l’AI Act.
En complément de l’AI Act, une directive sur la responsabilité en matière d’IA est actuellement en préparation.
TECHNOLOGIES EMERGENTES ET PROJETS A IMPACTS - Une évidence vertueuse par nature ? Le bitcoin et les critères ESG
Ciblé depuis sa création pour sa consommation énergétique, le Bitcoin est regardé sous un jour différent par un récent rapport du cabinet d’audit KPMG.
Alors que l’on oppose souvent le caractère polluant et l’utilisation à des fins criminelles de la technologie blockchain, et plus particulièrement du Bitcoin, le dernier rapport de KPMG diffusé début août, sur le rôle du Bitcoin pour les critères ESG (environnement, social, gouvernance), présente certains aspects de cette technologie sous un nouvel angle.
Le rapport de KPMG se réfère au Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index: si Bitcoin consomme en effet 0,55% de la production globale d’électricité, ses émissions de gaz à effet de serre ne représentent que 0,13% des émissions au global. Il est donc important de remettre ces indices en perspective par rapport à d’autres secteurs d’activité fortement émetteurs de gaz à effet de serre.
Le rapport propose 4 stratégies pour réduire l’empreinte carbone :
- l’utilisation d’énergies renouvelables dans le minage de Bitcoin : nécessitant d’importantes capacités de calcul, la consommation d’électricité représente un poste de coûts critique. C’est pourquoi les mineurs se sont mis en quête de sources d’électricité abondantes, et donc peu onéreuses, résultant souvent d’un surplus d’électricité issu du solaire, de l’éolien et de l’hydro. Notons pour l’exemple la ferme de minage située dans le parc du Virunga en République Démocratique du Congo, alimentée par l’une des trois centrales hydroélectriques du parc. L’activité des mineurs peut alors constituer une source de revenus vitale pour la survie de ces installations qui produisent à perte (prix négatifs de l’électricité), et ainsi participer au développement de l’économie locale ;
- la flexibilité des mineurs en fait des interfaces neutres en périphérie des réseaux : ils ont la capacité de se déconnecter du réseau afin de le soulager en cas de forte demande. Les mineurs participent ainsi à l’équilibrage du réseau ;
- le recyclage de la chaleur produite par les machines de minage : le rapport KPMG cite l’exemple de la ville de Vancouver Nord au Canada qui recycle la chaleur émise par les machines pour chauffer une centaine de locaux commerciaux et résidentiels. Le même mineur situé dans le parc du Virunga recycle la chaleur des machines et se lance dans l’activité de séchage de fruits, développant ainsi une industrie locale.
- des fermes de minages commencent également à récupérer l’énergie issue du torchage de gaz particulièrement émetteur de Co2.
Les critères sociaux, avec notamment les possibilités d’investigations, et de gouvernance sont également traités dans ce rapport et feront l’objet d’études ultérieures mais l’on peut déjà constater une forme de professionnalisation d’un secteur en plein essor qui n’a pas hésité à être force d’innovation afin de pleinement intégrer les impératifs ESG qui, pour certains, font partie de l’essence même de Bitcoin.
DROIT DE LA SANTE – La loi sur les influenceurs impacte les entreprises du secteur de la santé
Loi n°2023-451 du 9 juin 2023
La loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (ci-après « loi sur les influenceurs ») a des répercussions sur les entreprises du secteur de la santé.
La loi sur les influenceurs a pour objet d’encadrer l’activité d’influence commerciale par voie électronique (notamment sur les plateformes en ligne, dont les réseaux sociaux). Elle définit l’influenceur comme « toute personne physique ou morale qui, à titre onéreux, mobilise sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque ».
Cette loi s’applique à tous les influenceurs, établis en France ou à l’étranger, dès lors que leur activité s’adresse à un public établi sur le territoire français.
S’agissant du secteur de la santé, la loi sur les influenceurs soumet les influenceurs aux règles régissant la publicité des médicaments (art. L. 5122-1 à L. 5122-16 du Code de la santé publique), des dispositifs médicaux (art. L. 5213-1 à L. 5213-7) et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (art. L. 5223-1 à L. 5223-5). Elle les soumet également aux règles relatives aux allégations de santé portant sur les denrées alimentaires (règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006) et à celles sur la publicité pour les boissons avec sucres ou sels ajoutés, les boissons alcooliques, les produits du tabac et les produits du vapotage.
De ce fait, les influenceurs ne peuvent désormais promouvoir des médicaments auprès du public, que s’ils bénéficient d’une autorisation de l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament). En outre, ils ne peuvent pas, en toute hypothèse, promouvoir des médicaments sur prescription médicale obligatoire ou des médicaments remboursables par l’assurance maladie.
En outre, les influenceurs se voient également interdire la promotion de dispositifs médicaux pris en charge par la sécurité sociale ainsi que de tout acte, procédé, technique ou méthode à visée esthétique. Veuillez noter que cette interdiction englobe non seulement la chirurgie esthétique, mais aussi certains dispositifs médicaux à visée esthétique, tels que les cabines de bronzage à UV ou encore les équipements lasers.
Ainsi, seuls les dispositifs médicaux relevant des classes I et II, tels que les lunettes correctrices, lentilles de contact, aides auditives ou couronnes dentaires, peuvent faire l’objet de publicité par les influenceurs.
En cas de contravention à ces dispositions, les influenceurs et les entreprises partenaires s’exposent à des poursuites pénales et à des sanctions pouvant aller jusqu’à deux années d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende, outre une interdiction d’exercer. L’entreprise ayant eu recours aux services de l’influenceur peut en outre être tenue responsable solidairement.
Conseil de GGV : si vous êtes une entreprise dans le domaine de la santé, soyez attentif à vos partenariats avec des influenceurs situés en France comme à l’étranger !